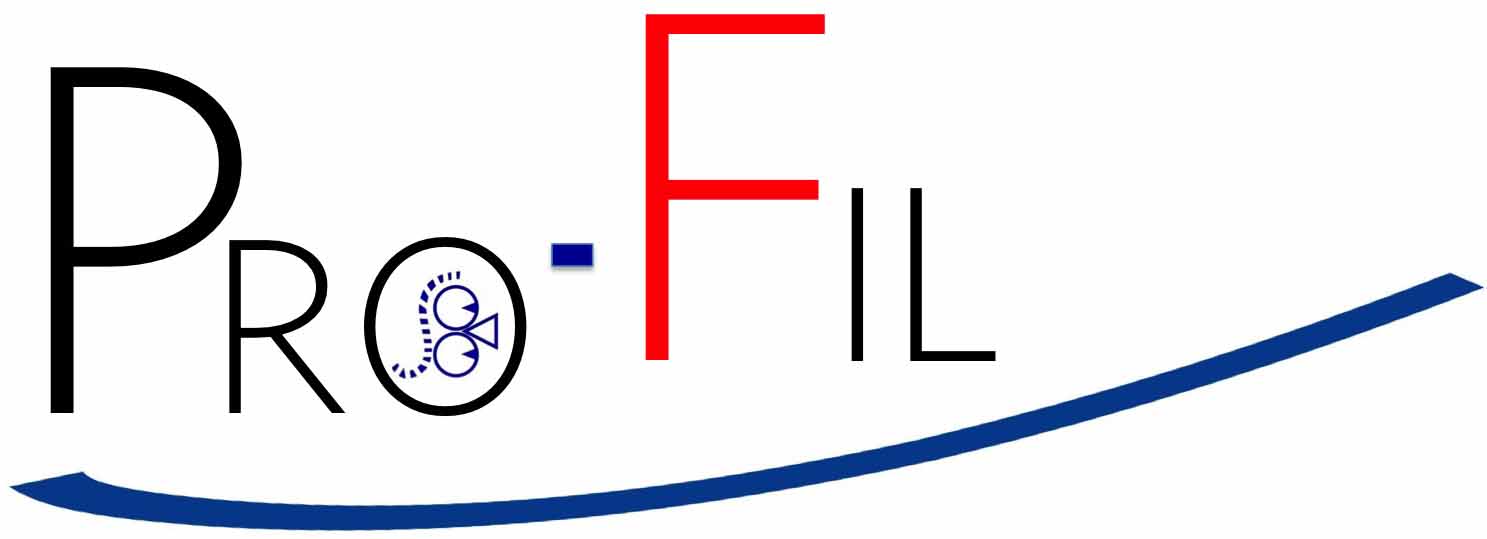
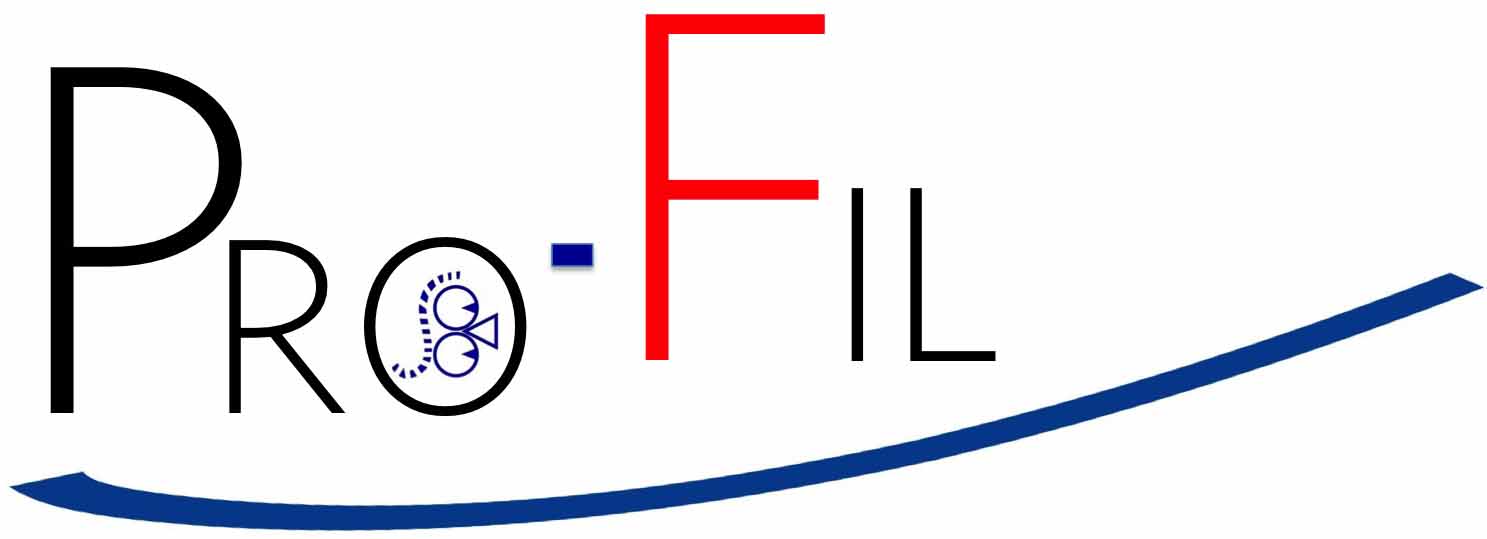 |
PROtestants et FILmophiles |
PROmouvoir les FILms dont la qualité artistique et humaine aide à la connaissance du monde contemporain
ACCUEIL - QUI SOMMES-NOUS ? - ACTIVITES - PUBLICATIONS - GROUPES - CRITIQUES DE FILMS - RADIO - FESTIVALS


Avec :
Masatoshi Nagase (Masaya Nagamori, le photographe qui devient aveugle), Ayame Misaki (Misako Ozaki, la jeune fille audio descriptrice), Tatsua Fuji (Kitabayashi et Juzo, réalisateur et acteur du film audio décrit).
Prix du jury œcuménique Cannes 2017
Réalisation et scénario : Naomi KawaseNaomi Kawase, née à Nara, Japon, en 1969 est diplômée de l’École de photographie d’Osaka. Elle a d’abord réalisé des documentaires, dont La danse des souvenirs en 2002, où elle accompagnait l’agonie d’un ami photographe. Ses films les plus récents sont Shara en 2004, La forêt de Mogari en 2007, grand prix du Festival de Cannes, Hanezu, l’esprit des montagnes en 2011, Still the Water en 2014 et Les délices de Tojyo en 2015. Elle a également publié deux romans.
Résumé :
Au cours de séances tests d’audio description d’un film dont on suit plusieurs séquences, Misako Osaki, jeune audio descriptrice, est l’objet de plusieurs critiques, dont celles de M. Nakamori, un photographe reconnu qui est en train de perdre la vue. Misako a perdu son père et sa mère est malade mentale. Tous les deux se rapprochent et Misako finit par emmener M. Nakamori, devenu aveugle, devant un coucher de soleil dans les dunes qui rappelle la fin du « film dans le film ».
Analyse :
Vers la lumière est un film composite où plusieurs fils narratifs s’entremêlent : l’audio description et l’évolution de Misako en fonction des critiques qui lui sont faites, l’accompagnement de l’agonie de son épouse par le personnage du film audio décrit, la rencontre de Misako avec M. Nakamori et leurs relations d’abord heurtées puis quasi amoureuses au fil de l’évolution de sa cécité, les retrouvailles à la campagne de Misako et de sa mère malade mentale et les sentiments d’amour et de mélancolie qui les réunissent. Le montage entrelace ainsi des scènes dans des lieux et des situations très différentes et plusieurs thèmes s’en dégagent : la difficulté à décrire oralement ce qu’on voit à quelqu’un qui ne voit plus, la compassion devant la souffrance d’un proche, le mystère de la cécité et la fascination qu’elle peut provoquer, la force des souvenir, la communion avec la nature.
Cette relative complexité s’accompagne de nombreux effets de mise en scène : effets de flou, plans courts et tremblants qui peuvent évoquer la cécité, plans très rapprochés des visages et des corps et plans très larges des paysages, des nuages, jeu continu de zooms et de recadrage, jeux de lumière. Ces effets ont donné lieu à de nombreuses appréciations négatives dans une partie de la critique : mièvrerie, sentimentalisme béat, symbolisme laborieux.
Le prix du Jury œcuménique montre qu’on peut au contraire être sensible à la recherche esthétique d’un film qui « nous invite par sa poésie à regarder et écouter plus attentivement le monde qui nous entoure » (Denyse Muller, présidente du jury).
Ce qui à mon sens fait l’unité du film ce sont les images : leur beauté, leur force dans l’esprit humain, leur interprétation, leur transmission, la douleur de leur perte et au-delà leur présence active même après leur disparition. Et qui dit images dit cinéma, le meilleur du film à mon avis est ainsi dans une réflexion sur qu’est-ce que voir ? Comment les mots peuvent-ils restituer ce qu’on voit ? Quelle est la part de l’imagination du spectateur dans la vision d’un film ?
Au final, le cinéma comme sujet de la représentation.
Philippe Raccah
Autres articles sur ce film
|
Siège social, 40 rue de Las Sorbes, 34070 Montpellier Secrétariat national, 25 avenue de Lodève, 34070 Montpellier |